Mandala est un terme sanskrit signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement, communauté, utilisé dans l'hindouisme, ainsi que le bouddhisme et le jaïnisme.
Il est composé des termes sanskrit « manda », signifiant « essence », et « la » signifiant « contenant ». Les mandalas sont en premier lieu des aires rituelles utilisées pour évoquer des divinités hindoues. Le bouddhisme héritier de ces pratiques utilise également les mandalas pour ses rites et ses pratiques de méditation.
Dans le bouddhisme vajrayāna, il existe différentes formes de mandalas, structure complexe peinte ou sculptée en ronde-bosse utilisée pour la progression initiatique, ou bien encore diagramme fait de sable coloré qui est utilisé principalement pour la méditation. Le diagramme est dans tous les cas rempli de symboles ; il peut être associé à une divinité. Certains mandalas, très élaborés et codifiés, en deviennent semi-figuratifs, semi-abstraits, tel le Gohonzon de Nichiren.
Les origines du mandala
Des proto-mandalas sont attestés pour leurs aspects politiques depuis le premier siècle avant notre ère. Le pouvoir du chef y était alors lié aux ancêtres et à l'esprit animiste.
Si des pratiquants du bouddhisme du peuple Yuezhi (de l'Empire kouchan) sont notés en Chine en -2, l'ère du bouddhisme de Chine commence probablement sous le règne de l'empereur Han Mingdi (règne, 58 — 75) étant le premier connu pour avoir eu un intérêt pour le bouddhisme, avec notamment la fondation du temple du Cheval blanc. Au début de l'arrivée du bouddhisme en Chine, des traités d'exégèse et des manuels de rituels y sont écrits. Le manuel de confession lors de l'introduction du bouddhisme en Chine. Le rituel de confession monastique (pratimokṣa), ne correspondant pas forcément à de réelles confessions, mais à un exercice de détachement de la vacuité. Ces confessions parfois de péchés imaginaires lui permettent de comprendre la vraie nature de toute chose (dharma). Des manuels sont écrits par des moines chinois dont certains ont plus d'importance pratique dans les rituels que les sūtra et vinaya. Les laïcs effacent alors leur péchés en se confessant suivant un rite au milieu d'un ensemble de moines. Avec l'arrivée des maîtres tantriques au viie siècle et viiie siècle, la pratique rituelle change. Les manuels de rites et méthodes de méditation sont souvent de patronage impérial. Un nouveau badhisattva est alors créé, ayant sa place au sein du mandala. Il est présenté comme ayant été rédigé par Amoghavajra au viiie siècle, il s'agit en réalité d'un tantra apocryphe fabriqué dans la Chine des Tang et pratiqué dans la région de Dunhuang. Le Taishō Canon japonais semble reprendre différents éléments des illustrations de ce tantra.
Le mandala selon les cultures
Dans l'hindouisme
Le maṇḍala n'est pas seulement une structure, c'est un lieu, une aire rituelle, d'invocation de la divinité. Il est donc l'outil de plusieurs rituels quotidiens sous sa forme de yantra, peinture de sable.
Il existe différentes variations du principe du maṇḍala dans l’hindouisme. le rangoli est fait de poudre de riz ou de fleur, le kōlam exclusivement fait par des femmes du Tamil Nadu, utilisant des motifs géométriques complexes, et auparavant exclusivement fait de poudre de riz. Au contraire, au Kerala, les kalam (ou kalampattu, kalam ezhutu), également en poudre de riz, sont fait uniquement par des hommes représentant des divinités anthropomorphes. Le mandana, fait de motifs géométriques est peint sur les murs (bhitti chitra) et le sol (bhumi chitra) par les femmes au Rajasthan et dans le Nord du Madhya Pradesh
Dans le bouddhisme
Dans le bouddhisme tantrique (vajrayāna), comme dans d'autres branches du bouddhisme, le mandala est un support de méditation. Celui-ci est le plus souvent représenté en deux dimensions mais on trouve également des mandalas réalisés en trois dimensions. Ce sont des œuvres d'art d'une grande complexité. Le méditant se projette dans le mandala avec lequel il se fond dans les concepts taoïstes du yīn et du yáng de la bouddhéité chan. Disposées en plusieurs quartiers, certaines déités expriment la compassion, la douceur, d'autres l'intelligence, le discernement, d'autres encore l'énergie, la force de vaincre tous les aspects négatifs du subconscient samsarique.
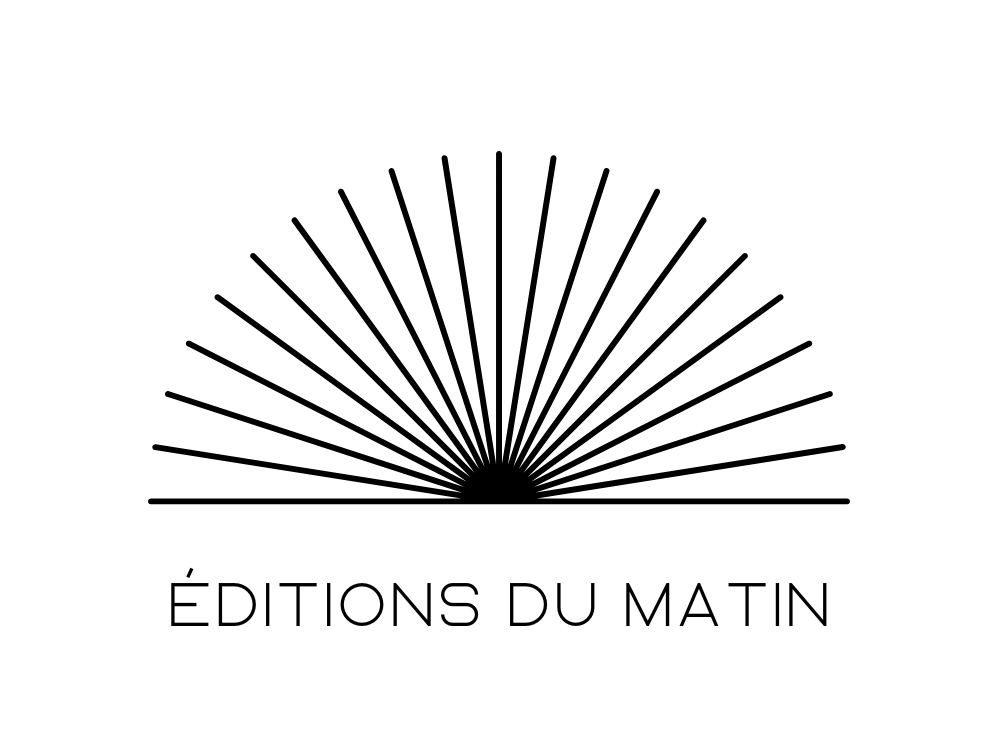
 Boostez votre blog
Boostez votre blog
 Voyager autrement
Voyager autrement
 Confiance en Soi
Confiance en Soi
 Le monde du silence
Le monde du silence
 5 spots méconnus
5 spots méconnus

